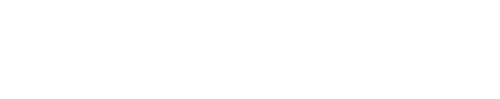À l’heure où les tensions entre l’Iran et Israël atteignent un nouveau paroxysme, les regards se tournent vers la possible accession de Téhéran au rang de puissance nucléaire. Pourtant, malgré des décennies d’efforts, l’Iran reste à la périphérie de ce cercle d’élus que l’on appelle — non sans crainte — les puissances atomiques. La raison n’est pas seulement politique : elle est d’abord technique, scientifique, presque vertigineuse.
Concevoir une bombe nucléaire ne relève pas d’une simple accumulation de savoirs ou de matières premières. Il s’agit d’un processus hérissé d’obstacles d’une rare complexité, qui explique pourquoi, en près d’un siècle d’ère nucléaire, seuls neuf États dans le monde ont réussi à en franchir toutes les étapes.
L’uranium, dont on tire la majorité des bombes, n’est pas utilisable tel quel. Dans sa forme naturelle, il est constitué presque exclusivement d’un isotope inerte pour les usages militaires : l’uranium 238. L’isotope recherché, l’uranium 235, n’en représente que 0,7 %. Il faut donc le séparer, l’extraire, l’enrichir — jusqu’à un taux de 90 % — en faisant tourner des milliers de centrifugeuses à très haute vitesse. Ce ballet silencieux requiert une infrastructure d’une sophistication extrême, un contrôle minutieux de la température, de la pression, des matériaux. Rien ne doit trembler.
Mais même une fois ce seuil atteint, le défi n’est pas achevé. Il faut ensuite réussir à provoquer l’embrasement de la matière fissile. Cela implique soit de projeter deux blocs d’uranium l’un contre l’autre avec une précision balistique absolue, soit de comprimer une sphère de plutonium par des charges explosives disposées en couronne. Le moindre retard, la moindre asymétrie, et c’est l’échec. Ou pire : l’implosion incontrôlée.
Et vient enfin la question de la miniaturisation. Car une bombe, pour être une arme stratégique, doit pouvoir être placée dans une ogive de missile. Il ne s’agit plus seulement de déclencher une réaction, mais de la contenir, de la guider, de l’activer à distance dans un espace réduit. Ce savoir-faire suppose un degré d’ingénierie qui échappe encore à de nombreux pays, même puissants.
Aujourd’hui, seuls les États-Unis, la Russie, la Chine, la France, le Royaume-Uni, l’Inde, le Pakistan, la Corée du Nord et Israël disposent officiellement de cette capacité. D’autres, comme le Japon, l’Allemagne ou l’Arabie Saoudite, possèdent les moyens intellectuels et industriels d’y parvenir, mais s’en abstiennent. Le coût exorbitant, les risques diplomatiques, la peur de représailles : tout concourt à freiner cette course.
Et c’est une bonne nouvelle. Car si l’arme nucléaire devenait banale, elle cesserait d’être dissuasive pour devenir tentatrice. Or, sa rareté demeure l’ultime verrou de notre équilibre précaire. Que ce verrou tienne encore, en 2025, relève moins d’un miracle que d’une incapacité universellement salutaire.